





« Arthur Cravan voyait sans doute venir ce monde quand il écrivait dans Maintenant : “Dans la rue on ne verra bientôt plus que des artistes, et on aura toutes les peines du monde à y découvrir un homme.” Tel est bien le sens de cette forme rajeunie d’une ancienne boutade des voyous de Paris : “Salut, les artistes ! Tant pis si je me trompe.” »
Guy Debord,
Commentaires sur la société du spectacle.
– Ne trouvez-vous pas curieux que, quels qu’ils soient, les critiques et les historiens d’art français de la seconde moitié du XXe siècle s’attardent si peu sur les conditions politiques qui ont présidé à la naissance et à la réalisation des œuvres qu’ils croient devoir prendre en considération ?
Arnold Simon1 est un ami de longue date. Nous nous sommes rencontrés à New York, à la fin des années 1970. Avocat d’affaires, il travaillait alors, entre autres, pour Thomas B. Hess, directeur de la revue Art News. Il est le seul New Yorkais que je connais qui collectionne aussi bien l’art américain que l’art français. Nous avons été très liés. Et lorsqu’il vient à Paris, il ne manque jamais de me faire signe.
Nous sommes installés au bar de l’hôtel Montalembert. Il m’annonce qu’il a commencé à écrire un livre sur Art News et Thomas B. Hess, qu’il considère comme un des plus importants critiques d’art américains, mal connu, injustement méconnu.
– En effet, les Français n’ont pu lire de lui que la très longue préface, en vérité un livre, qui servit de catalogue à l’exposition rétrospective de Barnett Newman présentée à Paris, dans les Galeries du Grand Palais, en 1972.
– Mais vous ? Vous l’avez connu. J’ai trouvé plusieurs lettres de vous dans ses archives. Et vous êtes, autant que je sache, le seul Français avec qui il a entretenu une correspondance.
– Connu… Oui. D’abord lors de mon séjour à New York en 1966. Il m’a proposé d’écrire dans la revue. Ce que j’ai fait à propos d’une exposition de Fernand Léger organisée par une galerie de Chicago. Nous nous sommes rencontrés quelques fois à la revue, et quelques fois chez lui, à Beekman Place. Sa collection fut pour moi une véritable révélation. Je pense notamment à sa collection de peintures de De Kooning. Puis nous nous sommes vus à Paris où il faisait de fréquents séjours. J’ai quelques lettres de lui. Mais la plus amusante est certainement celle où il me remercie de lui avoir envoyé Stanze. Qu’il ait répondu à l’envoi de ce livre, qui ne lui était, il faut bien le dire, que très peu destiné, m’a vivement touché. Et sur ce qui n’était donc même pas un malentendu, nous avons continué à correspondre.
– Justement, j’aimerais mieux comprendre ce qui vous occupait l’un et l’autre à l’époque, et sur quel terrain vous vous retrouviez.
– Lorsque je suis arrivé à New York en 1966, je n’avais pratiquement rien écrit sur l’art, et Tom Hess était alors responsable d’une des plus importantes revues d’art des États-Unis. Il était aussi nettement plus âgé que moi. Pourtant, ce qui m’a frappé, ce n’est pas seulement la spontanéité de son accueil, c’est que ce mouvement de sympathie répondait d’une culture non seulement attentive, mais très intelligemment curieuse de ce qui se passait à Paris. Il connaissait par exemple la revue Tel Quel, dont j’étais alors le responsable, et qui, comme vous le savez, n’était certes pas encore, dans ces années-là, très connue en France. Je dois ajouter que lors de ce premier voyage aux États-Unis, c’est très généralement que cette sympathie et cette curiosité se manifestaient. Aussi bien chez des critiques comme Harold Rosenberg que chez des directeurs de galerie, des directeurs de musée. William Rubin, qui était alors directeur du MoMA, m’a accompagné à plusieurs reprises chez des amateurs dont il souhaitait me faire connaître la collection. Il a lui-même souhaité plus tardivement, en 1977, écrire un livre en collaboration avec moi à l’occasion de l’exposition Paris / New York au Centre G. Pompidou. Il n’en fut pas autrement pour les peintres. Barnett Newman m’accompagna lui-même au musée Guggenheim pour que je puisse voir l’ensemble de The Stations of the Cross, dont l’exposition venait de fermer. La sympathie de Robert Motherwell fut immédiate. Et j’eus la surprise de découvrir en rencontrant Mark Rothko qu’il connaissait le texte que j’avais publié sur lui dans la revue Tel Quel, et le texte que Sollers venait de publier dans un numéro récent de Art en France. Ce qui se passait en France, à Paris, où ils étaient pourtant si mal accueillis, restait alors central pour les peintres et intellectuels américains.
– C’est sur ce point que j’aimerais mieux vous entendre. Comment Hess réagissait-il à votre discours dans une semblable situation ?
– Je n’ai jamais été très intéressé par ce que l’on appelait, à l’époque, la « Nouvelle École de Paris ». L’art et la peinture moderne, en France, ne me semblaient en rien représentés par les artistes qui occupaient alors les cimaises des galeries et celles d’un famélique Musée national d’art moderne. Ce que je découvrais aux États-Unis me semblait plus proche des ambitions de Matisse (mort en 1954), de Picasso (toujours vivant) et de Giacometti (qui venait de mourir), que ce qui s’exposait alors à Paris. Par ailleurs, vous vous souvenez certainement de l’humour et de l’esprit souvent très acerbe, caustique, de Thomas B. Hess. Son mot sur Clement Greenberg (« Clem a fait arranger ses dents de devant, enlevant ainsi le seul aspect honnête de son visage ») courait alors les salles de rédaction et les ateliers. Lorsqu’il reçut le premier numéro du magazine français Art Press, il m’écrivit : « Curieux cette revue qui porte le nom d’un drycleaner. » Je suppose qu’il n’en allait pas autrement en ce qui me concerne, il était à la fois curieux et amusé.
– Mais encore, vous parlait-il de vos publications sur l’art, votre série d’articles dans Les Lettres françaises, en 1967 ? Vous y citiez son livre sur Willem De Kooning, chez Braziller.
– Oui. Il était amusé mais précis. Ce que vous disiez tout à l’heure de la négligence des critiques et des historiens qui ne veulent rien savoir des conditions politiques objectives et subjectives qui président, à un moment donné, à la création des œuvres, cela lui semblait un point important à traiter, et notamment à propos de l’anti-américanisme, alors, et, il faut bien le dire, aujourd’hui encore, dominant en France. Mes interprétations, mes références à l’œuvre de Marx, notamment dans L’Enseignement de la peinture, en 1971, ne lui semblaient pas fausses, mais faussées par ce qu’elles oblitéraient. « Le mieux, disait-il, serait de conclure que l’art moderne est révolutionnaire mais que la révolution artistique n’est pas assimilable à la politique révolutionnaire. » Et il n’avait pas tout à fait tort.
Arnold prend son verre, et me regarde de biais.
– Il n’avait pas tort. Que voulez-vous dire ?
– C’est curieusement en me parlant de Leo Castelli et Ileana Sonnabend qu’il a abordé la question de la situation de l’art en France, et la transformation d’un pétainisme collaborationniste de circonstance en un stalinisme plus ou moins déguisé aux couleurs du parti communiste français… L’anti-américanisme étant une composante conventionnelle et quasi obligée de cette sorte de reconversion politique.
Arnold sait très bien de quoi il retourne. Il n’insiste que pour garder une trace de notre entretien sur le petit magnétophone qu’il a posé entre nous. Il me remettra d’ailleurs une copie de l’enregistrement.
– Avez-vous déjà évoqué publiquement cette conversation avec Tom Hess ?
– Non, jamais. Au demeurant, ce qu’il me disait n’était pas inconnu. En 1980, une de mes amies a fait un devoir de Maîtrise d’histoire de l’art sur la galerie René Drouin, en évoquant, bien entendu, le rôle de Ileana Sonnabend et de Leo Castelli, lors de l’ouverture de la galerie. Au début de 1939, grâce à l’argent prêté par les parents d’Ileana Sonnabend, Leo Castelli et René Drouin purent s’associer et ouvrir une galerie place Vendôme, à côté de l’hôtel Ritz. Cela me fait penser que nous eûmes cette conversation, Tom Hess et moi, en sortant de l’hôtel Ritz où, comme vous le savez, il descendait lorsqu’il venait à Paris… 1939 ! C’est l’année du pacte germano-soviétique. Hitler est au pouvoir depuis six ans. Comment aujourd’hui encore ne pas penser à cette Europe qui ne veut rien savoir de ce qui lui arrive, et qui, contre toute vraisemblance, veut croire que ce qu’elle dit ses « valeurs » la préserveront d’une catastrophe dont elles portent précisément les germes. L’Europe (Daladier pour la France) a déjà signé les accords de Munich avec l’Allemagne nazie. Quoi qu’il en soit, et nous savons ce qu’il en fut, après une expéditive et « drôle de guerre » (!), Ileana Sonnabend et Leo Castelli, parce que juifs, doivent quitter la France pour les États-Unis. Leur ancien associé, René Drouin, reprend la galerie de la place Vendôme où, pendant toute l’Occupation, il s’emploie à se constituer une nouvelle clientèle… Les activités marchandes de la galerie Drouin, au cours de cette période, restent difficiles à établir, les livres comptables ayant disparu. Les critiques de l’époque (Jean-Marc Campagne, Louis Hourticq, Louis Réau) qui préfacent les catalogues de la galerie sont des intellectuels proches de la collaboration. En 1944, Hourticq (de l’Académie) publie dans une revue nazie une apologie de la collaboration et de l’Europe allemande. Il n’y a aucun doute, durant l’Occupation, la galerie René Drouin fut proche de la collaboration, sans bien entendu, pour autant, collaborer. Cette situation était alors propre à un très grand nombre de Français. Les critiques et historiens qui traitent aujourd’hui de cette période, qualifient la ligne politique de la galerie Drouin de « ligne confuse » (sic).
Je constate que mon ami Arnold s’impatiente. Le temps passe. Il a, je suppose, des projets pour la soirée.
– Rien dans tout cela qui soit bien surprenant, et justifie l’anti-américanisme des Français après la guerre, bien au contraire le fait que tant d’Européens n’aient eu, lors de l’invasion allemande, d’autre refuge que les États-Unis, semblerait devoir démontrer exactement le contraire.
– En effet. Aussi n’était-ce là que le premier élément de la démonstration. La question, pour l’essentiel, porte sur ce qu’il en fut, à la Libération, dans les décennies qui ont suivi et sans doute aujourd’hui encore, des reconversions politiques de « la ligne plus ou moins confusément pétainiste et collaborationniste » des Français. Bref, de ce que Sollers a nommé « la France moisie ». En ce qui concerne la galerie Drouin, on ne peut pas ne pas constater que chacun a fait comme si rien ne s’était passé. Et que d’une certaine façon la galerie fut même encouragée à suivre cette voie. Dès 1943, il semble que certains amis ou proches de Drouin aient réussi à influencer le galeriste et à le convaincre d’infléchir sa première ligne « confuse » et à exposer les œuvres de Fautrier. Dès la fin de la guerre, Malraux, Paulhan, la NRF participent à la nouvelle « ligne » de la galerie, qui exposera Dubuffet. Et l’on peut supposer que les conseillers et l’opportunisme d’époque durent alors jouer un rôle important puisque le 9 février 1945 la galerie présente une exposition d’œuvres contemporaines destinées à être vendues aux enchères au profit des prisonniers de guerre et des déportés soviétiques. La préface à cette exposition précise que « l’Armée rouge ne défend pas seulement l’Union Soviétique. En portant à la bête nazie les coups les plus rudes, c’est elle qui travaille le mieux à la libération des peuples ». En lisant cela, on pourrait supposer que René Drouin a échangé Hourticq contre Aragon. Il est d’ailleurs à noter qu’en 1962 René Drouin préféra fermer sa galerie plutôt que de la reconvertir à ce que lui proposaient Ileana Sonnabend et Leo Castelli.
– Il y eut, dites-vous, un devoir de Maîtrise d’histoire de l’art sur ce sujet ?
– Mon amie a travaillé sur l’histoire de la galerie René Drouin dans un cadre universitaire, qui exclut, cela va de soi, toute interprétation politique ; mais l’essentiel des informations dont on peut disposer s’y trouvent. C’est l’évocation de ma conversation avec Tom Hess qui m’entraîne à remarquer qu’en France le blanchiment des consciences pétainistes a passé par un soviétisme et un stalinisme communiste obligé avec, en conséquence, un anti-américanisme militant… L’Amérique ne fut-elle pas le refuge de ceux que le nazisme, le fascisme et le stalinisme chassaient d’Europe… une façon de participer à « la libération des peuples » qui l’a entraînée à entrer dans la guerre et à la gagner. Les peuples qui ont été libérés par les Russes ne sont pas près de l’oublier. Curieux qu’un si grand nombre de Français et pendant si longtemps, et aujourd’hui encore, ne se pardonnent pas d’avoir été libérés par les Américains.
Arnold, qui vient de m’entendre dire ce qu’il souhaitait me faire dire, semble mal à l’aise, nerveux. Arnold est un intellectuel de la gauche cosmopolitique pour laquelle il faut que la France soit à la fois réelle et… imaginaire.
– Êtes-vous certain que la situation fut, après guerre, aussi généralement et politiquement mafieuse ? Après tout, en 1945, vous aviez à peine douze ans.
– Justement. J’ai dû dégager au quotidien les conditions politiques qui présidaient à ma formation. Et je parle d’expérience, en tenant compte des faits que j’ignorais mais qui s’imposaient à moi quotidiennement et de mille façons. Vous remarquerez d’ailleurs que je n’aborde pas les grandes lignes et les manifestations sociales et politiques officiellement actives dans l’immédiat après-guerre. Au demeurant, elles sont bien connues. Leur dernier avatar fut quatorze années de mitterrandisme. Qui plus est, pour un écrivain, un peintre, un musicien, les micro éléments, les faits concrets, les détails d’un ensemble sont aussi significatifs, sinon plus, que de larges généralités. Voulez-vous un autre exemple de ce mouvement de reconversion, tel qu’il se manifeste dans l’immédiat après-guerre, avant de devenir implicitement une norme de la vie culturelle de ce pays ? Le fait m’a lui aussi été rapporté par Tom Hess, et il est vérifiable. Je l’ai vérifié. En 1945, Stravinsky (autre artiste à trouver refuge aux États-Unis) reçoit une lettre lui proposant de publier sa Poétique musicale en France (la première édition fut éditée par Harvard University Press, en 1942), il accepte. Peu de temps après, le directeur de la collection, Roland Bourdariat, lui écrit qu’il semble peut-être inopportun de publier actuellement la cinquième partie du livre, intitulée « Les avatars de la musique russe », qui comporte des critiques sur la situation de la musique en Union Soviétique : « Il nous semble peut-être inopportun de publier actuellement la cinquième leçon d’autant que la censure militaire risque fort de l’interdire. Je pense que l’on pourrait très bien faire paraître l’ouvrage amputé de ce chapitre sans que l’ensemble en souffre. » Roland Bourdariat reviendra sur sa demande une nouvelle fois : « […] il est à craindre, outre les violentes polémiques qu’il susciterait [ce chapitre sur la musique russe et soviétique], que la censure n’y trouve à redire. » Depuis 1944, le Gouvernement provisoire de la République, qui sera présidé par de Gaulle jusqu’en 1946, est installé à Paris. Que craignent donc l’éditeur et les amis de Stravinsky, et pourquoi croient-ils devoir pratiquer cette autocensure sur tout ce qui touche l’Union Soviétique ? Ce qui se signale là n’a jamais vraiment été traité en tant que tel, et en conséquence n’a cessé d’empoisonner l’atmosphère de ce pays.
– Mais en ce qui vous concerne, comme expliquez-vous, dans un tel contexte, votre intérêt pour la peinture américaine de la seconde moitié du XXe siècle ?
– J’étais peut-être un peu moins anti-américain que beaucoup. Et puis, voyez-vous, je ne me suis jamais considéré comme un vaincu. En somme, contrairement à mes aînés, je n’ai pas perdu la guerre. En 1949, j’avais tout juste seize ans, je me suis retrouvé seul à Paris. J’y ai fait mes classes. Paris, alors, ne ressemblait en rien à ce que vous pouvez en voir aujourd’hui. Paris était alors une ville grise, mais le luxe, la lumière était étonnamment libre de l’intérieur. Je n’avais pas d’autres obligations que d’aller vers ce que j’aimais. Et le partage s’est fait de lui-même. Tout à disposition. La bibliothèque, le Louvre, les Tuileries, le Jeu de Paume… Il était, comme aujourd’hui, très difficile d’éprouver son existence en lisant Rimbaud, ou en contemplant une peinture de Cézanne, et d’accorder le moindre crédit à ce qui se publiait et à ce qui s’enseignait à l’École des Beaux-Arts, par exemple… Très difficile d’imaginer que Beaudin puisse exister en même temps que Matisse, et que Picasso puisse être assimilé aux petits écrans grillagés, plus ou moins géométriques, de Singier, Manessier, Viera da Silva, Bazaine, et j’en passe. Lorsque j’ai vu les œuvres des peintres américains – et je crois que le premier que j’ai réellement vu ce fut Motherwell, dont la White Chapel Gallery de Londres présentait une exposition rétrospective –, j’ai eu le sentiment que ces artistes témoignaient d’une énergie et d’une ambition susceptible en effet de les confronter avec ce qui s’était produit de plus spectaculairement heureux à Paris. Le sentiment dominant de la grande génération des artistes américains des années 50, fut un sentiment de concurrence avec Paris. Comme le reconnaissaient Tom Hess, Pollock et Motherwell, entre autres, Picasso et Guernica restaient au fond des esprits. Rothko reconnaissait explicitement sa dette vis-à-vis de Matisse. La dernière lettre que j’ai reçue de Motherwell témoignait de son admiration pour Picasso. Et que dire d’Arshile Gorky, de De Kooning… ? N’y aurait-il que deux artistes de l’envergure de Matisse et Picasso à Paris en moins d’un siècle, c’est déjà beaucoup, c’est déjà trop. N’est-ce pas aussi la raison pour laquelle les intellectuels, les idéologues et les artistes américains ont ensuite voulu croire qu’il n’y avait plus rien, suivant en cela le désir profond d’un certain nombre de Français, ceux qui furent définitivement les vaincus, et pour plusieurs générations, de la Seconde Guerre mondiale ? Mais qu’est-ce qui en France fut réellement vaincu par l’arrivée des troupes américaines, si ce n’est ceux qui, tout de même, explicitement ou implicitement, attendaient et attendent toujours quelque chose de ce que représentait Pétain. C’est là l’image d’une certaine France, aujourd’hui « moisie » et toujours là, en l’état si je puis dire ; mais ce ne fut sans doute jamais l’image de Paris. Vous pouvez encore assez souvent entendre des intellectuels ou des écrivains français, généralement populistes, partir en guerre contre le « parisianisme », la littérature de Saint-Germain-des-Prés (ce qui implicitement signifie qu’ils n’en ont pas fini avec Sartre), ou les « clubs » du 6e et du 7e arrondissements. France Culture, la radio bien nommée, s’est fait une spécialité de ces sortes de déclarations. De quoi s’agit-il ? De Paris, de l’histoire de Paris. Au XVIe et au XVIIe siècles, ces quartiers furent les quartiers des libertins (« guéris du sot », comme on disait joliment à l’époque), puis les quartiers des « Lumières ». Lisez ce qu’il en est dit par exemple sur les murs des immeubles du quai Voltaire. Ces Français du ressentiment pétainiste n’en ont pas fini avec Sartre comme ils n’en ont pas fini avec Voltaire. Ils ne haïssent rien tant que l’air de liberté et l’esprit qui traversent la Seine au pont Royal pour, du Louvre et des Tuileries, se diffuser sur la place Vendôme, sur le Palais Royal, sur l’Opéra, sur la place de la Concorde… Ils ne haïssent rien tant que la mémoire que respire cet Air de Paris (que Marcel Duchamp a mis en boîte, à tous les sens du mot, parce qu’en effet cet air-là se prête spirituellement au jeu, à tous les jeux). Ce qui m’a toujours frappé, en vivant à Paris, c’est que – dans cette ville historiquement, symboliquement, poétiquement riche de ce qui l’a traversée, et qui reste aujourd’hui encore particulièrement vivant – l’expérience active de la mémoire ne cesse d’être présente et de s’actualiser, ici, aujourd’hui, maintenant, comme chaque jour, assumant, en quelque sorte, l’ensevelissement, comme déchets, ordures, de ce qui n’est pas à sa taille. Installez-vous à l’angle du quai Saint-Michel et de la rue Privas, et dites-moi s’il est rien de plus vrai, de plus actuel, de plus « contemporain » que la Vue de Notre-Dame de Paris par Matisse ; bien que ce tableau ait été peint en 1914. Quelqu’un s’est-il jamais demandé pourquoi Matisse avait peint ce tableau en 1914 ?
Arnold s’inquiétait de son prochain rendez-vous. Nous quittons l’hôtel Montalembert, passons la rue Sébastien-Bottin, la rue de Beaune, le quai Voltaire, le pont du Carrousel. Nous marchons jusqu’aux guichets du Louvre. Le soleil se couche somptueusement derrière l’Arc de Triomphe, il s’allonge sur les jardins des Tuileries, traverse la pyramide de Ieoh Ming Pei, et embrase d’une chaude lumière de sable rose l’architecture de Lefuel, et toute la cour Napoléon. Il se fait tard. Mon ami Arnold me quitte place du Palais Royal. Il est de toute évidence, comme beaucoup d’autres touristes à Paris, pressé d’aller se perdre et se retrouver dans les quartiers chauds du quatrième arrondissement.
Marcelin Pleynet.
Texte inédit. Juillet 2000.
« L’on n’a guère vu jusques à présent un chef-d’oeuvre d’esprit qui soit l’ouvrage de plusieurs. »
La Bruyère
« Veramente quel uomo e stato un grande istoriatore e grande favoleggiatore. »
Bernini
Toujours l’art de Poussin surprend et intrigue, et d’abord par sa clarté. André Gide écrit en 1918 : « La très grande clarté, comme il advient souvent pour nos plus belles œuvres françaises, de Rameau, de Molière ou de Poussin, est, pour défendre une œuvre, la plus spécieuse ceinture ; on en vient à douter qu’il y ait là quelque secret ; il semble qu’on en touche le fond d’abord. Mais on y revient dix ans après et l’on entre plus avant encore2. » De son côté Philippe Sollers écrit, quelque quarante ans plus tard, en 1961 : « “Étrange”, “mystérieux”, sont des mots que Poussin provoque...3 ». Et dans un tout autre ordre d’idées, n’est-ce pas ce que met en évidence Jacques Thuillier lorsque, dans son introduction au récent catalogue consacré à Simon Vouet, il croit devoir justifier une éventuelle concurrence entre les deux artistes en déclarant curieusement : « L’antagonisme qu’ils avaient mis en scène révéla surtout les limites que le génie de Poussin s’était assignées à lui-même...4 ».
Et de fait on peut parler de la génération de Vouet, Stella, Vignon, La Tour, on ne parlera jamais de la génération de Poussin. C’est que paradoxalement la figure de Poussin, qui se confond avec celle du classicisme français, est inassimilable à la production picturale du XVIIe siècle ; où, pour l’y retrouver, il faut, comme le fait Jacques Thuillier, la diminuer. C’est seul et de loin que Poussin marque son siècle. La tentative, à laquelle il se prête de très mauvaise grâce, pour l’assimiler à la cour de Louis XIII et au milieu parisien, n’aboutit pas. Le plus prestigieux des peintres français aura travaillé à Paris moins de deux ans, et réalisé la grande majorité de ses chefs-d’œuvre à Rome. On sait que Poussin quitte pour la première fois Paris à l’âge de vingt-neuf ans, et n’y revient que sur l’invitation du cardinal de Richelieu en décembre 1640 (il a quarante-six ans) pour, à l’automne 1642, repartir définitivement pour Rome où il meurt en 1665.
Comme l’écrit très bien Philippe Sollers : « Poussin, c’est aussi une leçon de rhétorique sur le choix des moyens et l’ordre de leur mise en œuvre ; de rhétorique profonde, en ce qu’elle apparaît naturelle au plus haut degré5. » Et si l’art de Poussin se confond ainsi avec l’art français (Cézanne dira vouloir « faire du Poussin d’après nature ») et fonde le classicisme, c’est peut-être d’abord, en effet, parce que la distance rhétorique fut, chez lui, à ce point effective. On n’entend rien à la manière de Poussin si l’on ne retient pas que l’admirable et sévère Autoportrait qui est au Louvre est celui du « peintre des Bacchanales » (en 1635 Poussin copie Le Festin des dieux, tableau commencé par Giovanni Bellini et terminé par Titien), du peintre de L’Inspiration du poète (autour de 1630), du Paysage avec saint Mathieu et du Paysage avec saint Jean à Patmos (peints l’un et l’autre l’année de son retour à Rome).
Le choix des moyens et l’ordre de leur mise en œuvre impliquent que l’on tienne compte de l’étonnante diversité d’inspiration et d’invention que maîtrise l’art du peintre. Dans le grand ouvrage qu’il vient de publier sur Poussin, Alain Mérot déclare qu’une certaine critique a fait « la part trop belle à une érudition livresque et encyclopédique que Poussin était loin de posséder...6 ». Et l’on peut sans doute convenir que la science de Poussin fut à la fois moins encyclopédique et plus considérable que celle que lui attribue une critique dont l’expérience reste en effet livresque.
Ce n’est pas seulement, dès l’âge de vingt-six, vingt-sept ans, la décision de quitter Paris et d’aller s’installer à Rome (bien que ce voyage soit alors une aventure) qui témoigne du caractère aussi réfléchi qu’existentiel de la « science » du peintre. Tout ce que l’on sait de sa biographie, et l’on en sait beaucoup plus que les historiens et les biographes veulent bien le reconnaître, confirme le trait d’un caractère exceptionnel. La vocation du peintre est tardive et ne peut pas ne pas faire événement dans une famille paysanne qui n’est pas sans relation avec la bourgeoisie. Même si l’on s’emploie à démontrer le parcours convenu de la carrière de Poussin, comme le font certains biographes, il faut reconnaître que ce parcours est initialement moins préparé que ne le fut celui d’un certain nombre d’autres artistes de ce XVIIe siècle qui, comme par exemple Simon Vouet, sont fils de maîtres peintres.
On suppose que Poussin a étudié au collège des Jésuites de Rouen jusqu’en 1610-1611. Félibien détermine la vocation de Poussin à partir de sa rencontre avec le peintre Quentin Varin qui arrive aux Andelys entre 1611 et 1612. Encouragé par Varin, Poussin précipite les événements et moins d’un an plus tard il quitte sa famille pour se rendre à Paris. Ce premier déplacement sera accompagné de nombreux autres ; les années d’études, disons de 1612 (Poussin a dix-huit ans) à 1622, vont être ainsi ponctuées d’événements peu conventionnels. À peine deux ans après son arrivée à Paris, Poussin accompagne un jeune seigneur, Alexandre Courtois, qui a l’intention de lui faire décorer sa demeure du Poitou. Le projet se révélant irréalisable, Poussin rentrera à Paris par ses propres moyens, entreprenant « à pied un chemin aussi long, dont il finit par venir à bout non sans beaucoup d’épreuves et de fatigues7 ». L’une des figures les plus officielles de l’art français commence sa carrière comme un « petit peintre ambulant, mendiant ici ou là une commande pauvrement récompensée. Cette sorte de peintre sans feu ni lieu [...] n’était guère mieux traitée que les ramoneurs ou les montreurs d’ours8 ». Cette aventure sera suivie autour de 1617-1618 de la décision de se rendre à Rome. Voyage qu’il entreprend et qui se termine à Florence d’où il rentre à Paris « par la suite de quelque accident9 ». Les informations que rapportent les biographes du XVIIe siècle (qui sont déjà des hagiographes) laissent supposer que Poussin se rendit ensuite à Lyon, où il vécut quelque temps, et que de nouveau s’éveilla pour lui « l’envie aiguë de voir Rome […] encore qu’il ne se trouvât pas fort pourvu d’argent, ayant imprudemment dépensé tout ce qu’il avait avec des amis ; mais il espérait s’en procurer en peignant en chemin10 ». « À ce propos Nicolas contait que, ne lui étant resté qu’un écu de tout son avoir, se moquant de la Fortune [...] le soir même il le dépensait joyeusement à dîner avec ses compagnons11 ».
Ces anecdotes ne feraient que colorer la légende du peintre si l’occasion qui détermina finalement le séjour de Poussin à Rome ne venait en confirmer le caractère. N’est-ce pas en effet par l’intermédiaire du célèbre Giambattista Marino (le Cavalier Marin) que se réalise l’installation de Poussin à Rome ? Or le Cavalier Marin, que Poussin rencontre à Paris entre 1622 et 1623, est loin d’être un personnage conventionnel. Poète lauréat de la cour de France, le Cavalier Marin fréquente les libertins d’esprit et de mœurs (ceux qui se disent alors les « déniaisés12 »), Tallemant des Réaux le présente comme participant à l’une des orgies qui occupent en ces années le libertinage parisien13. Il est un très informé lecteur de Lucrèce, et « un admirateur inconditionnel de Galilée, en qui il voyait un “inventeur” de merveilles “jamais vues”14 », et le grand poème L’Adone, qui fait de lui le plus grand écrivain italien vivant en cette première moitié du XVIIe siècle, sera condamné et mis à l’index en 1627.
Ce n’est pas le moindre des esprits de ce siècle qui protège Poussin de 1622 à 1625, qui facilite l’installation à Rome, et qui le recommande au cardinal Francesco Barberini en des termes particulièrement éclairants quant à la personnalité du peintre : « Vederete un giovane che a una furia di diavolo15. » Vous verrez un jeune homme qui a l’emportement (la fureur, l’impétuosité) d’un diable. Poussin est alors âgé de vingt-neuf ans. En ce début du XVIIe siècle, à vingt-neuf ans, l’homme est encore jeune mais déjà plus ce que nous entendons par « jeune homme ». C’est en tout cas un caractère peu convenu et attaché à un milieu et à un homme aussi peu conventionnel que possible, qui arrive à Rome en mars 1624.
Faut-il penser que la mort de son protecteur (le Cavalier Marin) en 1625, la condamnation du poème (L’Adone) pour lequel il a réalisé un certain nombre de dessins, changent de tout au tout son mode d’être, de sentir et de penser dans les années qui suivent ? À partir de 1625, la biographie de Poussin tend heureusement à se confondre avec l’histoire de son œuvre. Pourtant seize ans plus tard, Poussin a alors quarante-cinq ans, l’invitation du cardinal de Richelieu à venir travailler à Paris pour Louis XIII, et les péripéties du séjour parisien, soulignent les mêmes traits de caractère indépendant, et le même goût pour la compagnie de penseurs libertins.
C’est un peintre en pleine possession de ses moyens et au sommet de sa gloire que l’on retrouve à Paris le 5 avril 1642 dans une société que n’aurait pas reniée le Cavalier Marin. Les libertins réunis à la « petite débauche virtuosa16 » du 5 avril ne sont-ils pas aussi proches de cet autre protecteur romain de Poussin, Cassiano dal Pozzo, ami de Galilée ? On trouve là Pierre Bourdelot, que Poussin a connu à Rome, Gabriel Naudé, qui revient de Rome et lié à dal Pozzo, et « une des figures majeures du mouvement libertin », Pierre Richer, qui fait partie du cercle de Naudé, Guy Patin, également lié à Naudé, Pierre Gassendi, philosophe interprète de l’atomisme d’Épicure dont il fait un rival tout puissant d’Aristote, et Poussin. Une compagnie ne comptant que les esprits les plus brillants (Guy Patin les disait : « guéris du sot17 »), et un peintre dont tout tend à démontrer qu’il n’était pas là par hasard.
À quarante-cinq ans, Poussin n’est pas plus conventionnel qu’à vingt-neuf. Il faut voir ce qu’il en est de la biographie et de l’installation de Vouet en ces mêmes années, pour comprendre que Poussin cède une place qui n’est pas la sienne et prend définitivement vis-à-vis des peintres de la cour, et vis-à-vis de son siècle, la distance nécessaire à cette clarté d’invention et de pensée qui n’est qu’à lui seul. Distance : intelligence rhétorique qui est celle du milieu de penseurs, médecins, bibliothécaires, écrivains, que fréquente Poussin. Distance : intelligence rhétorique qui justifie aussi comme discours la place et l’œuvre de Poussin dans ce milieu. En septembre 1641, il écrit de Paris à Cassiano dal Pozzo : « Je le jure à V.S., si je restais beaucoup de temps dans ce pays, il faudrait que je devinsse un bousilleur comme les autres qui sont ici. » Il écrit encore plus déclarativement : « C’est un grand plaisir de vivre en un siècle là où il se passe de si grandes choses, pourvu que l’on puisse se mettre à couvert en quelque petit coin pour pouvoir voir la comédie à son aise. »
On constate et on s’étonne que de « ce petit coin » (!), Rome, Poussin, dès son retour, en 1643, se plaise particulièrement à la lecture des Essais de Montaigne, le seul auteur qu’il cite dans sa correspondance. Faut-il, comme certains le font, ne voir là qu’une limite de la curiosité intellectuelle de Poussin ? Ne faut-il pas, tout au contraire, y voir la poursuite d’une même politique et une fidélité à sa propre pensée, comme à celle des hommes qui lui permirent de se réaliser et de réaliser son œuvre en toute liberté ? Pourquoi ne pas considérer la présence de Montaigne dans les lettres de Poussin en fonction des vers de Lucrèce (ce poète latin si cher à Giambattista Marino) qui viennent pratiquement conclure le IIIe Livre des Essais : « Ce que je ne puis exprimer je le montre du doigt : ces brèves indications suffisent à un esprit pénétrant, à leur lumière tu pourras découvrir le reste par toi-même. »
Marcelin Pleynet.
ENSBA, 1991.
I. Le privilégié pourra choisir à tous moments l’âge qu’il souhaite avoir.
II. Le privilégié pourra s’il le souhaite se trouver dans plusieurs lieux à la fois.
III. Il pourra à volonté connaître les pensées de ses interlocuteurs.
IV. Son portefeuille contiendra toujours la somme dont il aura besoin.
V. Il pourra changer d’apparence selon son choix.
VI. Pendant ses activités sexuelles, pour lui et pour ses partenaires, le temps sera effectivement suspendu.
VII. Il gardera en mémoire tout ce qu’il lit, tout ce qu’il voit, tout ce qu’il pense, tout ce qu’il ressent, tout ce qu’il vit, mais avec le privilège de n’en évoquer que ce qu’il souhaite.
VIII. Le privilégié écrira à la vitesse de la pensée et avec la précision de la musique.
IX. Le privilégié pourra jouir du bien pour le bien. Il pourra jouir du mal pour le mal. Mais il pourra aussi à volonté haïr le mal. Il ne pourra jamais haïr le bien.
X. Dieu exauce les vœux du privilégié et les lui pardonne.
XI. Le privilégié reste lucide et heureux jusqu’à sa mort qui l’emporte sans douleur pendant son sommeil.
XII. Le privilégié ressuscite le troisième jour et choisit son destin.
Marcelin Pleynet, 1986.
Blévy, 1er janvier 1997
De la fenêtre du bureau la vue s’étend jusqu’à la rivière et la ligne des peupliers qui ferment l’horizon. Depuis des années et des années et plus encore, chaque matin, à l’aube, cette campagne d’Eure-et-Loir s’ouvre comme de l’intérieur sur l’horizon sans fin, la prairie proche, les champs du ciel… Des nuages parfois passent sur la page blanche où déjà une voix se fait entendre et qui ne consiste qu’à être là, immobile derrière cette table comme une fenêtre sur la terre… J’imagine… Non, je n’imagine rien. Chaque matin à cette table, à l’aube, rien d’autre… le temps de prendre mon stylo et de traverser la page… le charme du jardin, les magnolias, le parc, l’allée et la perspective entre les grands chênes, la prairie. Au fond le ruban de la rivière, une barre d’argent, les peupliers. Chaque matin tout s’ouvre à nouveau devant moi sur la voie droite.
Je suis sans doute le seul à pouvoir faire ce qu’ils attendent. Et cette occupation en vaut bien une autre. Enfin je le connais mieux que quiconque. Il vit là, tout à côté. Lorsque j’ai acheté cette maison, il y a bien des années, je la savais proche de la Ferté-Vidame. Venant de Chartres, comme de Dreux, on s’élève et on sent l’air devenir plus humide et plus froid. Les brouillards sont épais et fréquents. Il gèle plus tôt en automne et plus tard au printemps. Les plus belles forêts sont là, celle de la Ferté, de Senonches, de Châteauneuf, les bois de Jaudrais. Le château fut détruit, reconstruit, détruit à la Révolution, reconstruit, brûlé. Il n’est plus qu’une géante carcasse qui découpe le ciel de ses fenêtres vides. L’église fut édifiée par son père en 1658, façade de briques roses, pilastres, volutes et fronton ; accueillante, familière et calme, toujours vivante aux premières heures. Aux premières heures, Monsieur de Saint-Simon sort de sa maison. Le jour est à peine levé. Une matinée grise. Son haleine se fige dans l’air froid. Il se tourne vers la forêt que découpent de grandes allées en étoile. Elles sont toujours là. Il est toujours là à la première messe, dans la chapelle, seul avec le curé. Les deux hommes ne se parlent pas. Silence humide. La même cérémonie silencieuse chaque matin. Parfois quelques paroles rares, toujours les mêmes d’une année sur l’autre. C’est comme s’il n’y avait plus de temps, comme si on entrait dans le temps, comme s’il n’y avait plus d’année. Chaque matin sortir pour aussitôt entrer dans la bibliothèque et se mettre à sa table devant un grand feu. Le clavier, le crépitement de la méditation et la mémoire devant ce feu qui brûle. « Nul événement général ou particulier historique n’annonce nécessairement ce qu’il causera, et fort souvent fera très raisonnablement présumer au contraire. »
De 1723 à 1755 le mémorialiste travaille à la Ferté-Vidame : « Celui qui écrit l’histoire de son temps, qui ne s’attache qu’au vrai, qui ne ménage personne, se garde bien de le montrer. Que n’aurait-on point à craindre de tant de gens puissants, offensés en personne ou dans leurs plus proches par les vérités les plus certaines et en même temps les plus cruelles. Il faudrait donc qu’un écrivain eût perdu le sens pour laisser soupçonner seulement qu’il écrit. »
Je vous le ferai comme vous voulez.
L’église de Blévy est au moins deux fois plus grande que celle de la Ferté. J’en fais le tour pour rentrer chez moi. On n’y célèbre plus la messe que trois ou quatre fois l’an. Alors je l’entends résonner comme un bourdon, épaisse, lourde des voix qui s’élèvent sous les voûtes. Puis elle se vide à nouveau, elle est là, fidèlement, basse, chaude, massive dans son sommeil.
Je vous le ferai comme vous voulez, mais à ma manière.
Le bruissement des arbres. Le ciel maintenant doré. Les premières couleurs. Je les emporte avec moi. Ici et là… la même transparence, le même accueil matinal. Ici comme à Florence, à Rome, à Taormina ou sur la mer Égée. Tout pareil. Le même entretien et cette percée de la lumière grise, rose ou bleue qui s’impose progressivement. À Dublin, Buck Mullingan, dans l’air suave du matin, psalmodiant « Introïbo ad altare Dei ». Ça commence comme ça, les dieux ne sont pas loin, quelque chose est attendu. Bénie soit la clarté qui bénit.
Ici chaque matin trace la perspective, et les ombres peu à peu, elle conduit aussi loin que mon cœur peut le désirer. Et encore bien plus loin, jusqu’au détroit, jusqu’à la passe où des voix se font entendre d’un charme inouï et qu’il faut écouter sans les suivre. Chaque matin aux premières heures, comme au premier jour de l’année, quelque chose est attendu, une certitude qu’il faut risquer. Ils le savent si bien qu’ils en rient. C’est comme un rire léger qui froisse la surface de l’eau et argente le feuillage des oliviers. Chaque seconde immobile, chaque minute suspendue dans l’instant, construite suspendue en elle-même et déjà conduite, précipitée dans le jour qui vient. Appuyé sur cette pesanteur, chaque matin la feuille blanche est comme une roue ouverte à toutes les révélations, chaque éclat sur le mur, sur la prairie, les premières notes d’une partition. Immobile et conduit je trouve, je retrouve la vision assurée, la mémoire et l’oubli ouverts aux deux bouts… et le cheminement sur la terre.
La reliure des livres brille dans la pénombre, le jour à la fenêtre le dispute à la clarté des lampes. Le soleil passe de l’autre côté.
Fiction vivante. Hommage à la pensée du mémorialiste, le premier jour de l’an.
Marcelin Pleynet, « Situation »,
L’Infini, n°58, été 1997.
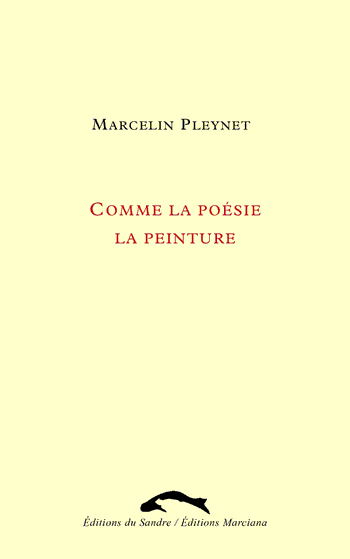
Notes de lecture
1 Arnold Simon est un nom fictif, mon interlocuteur n’ayant pas souhaité signer les propos et les intentions que je lui attribue.
2 A. Gide, Journal, « Bibliothèque de la Pléiade », Gallimard.
3 Ph. Sollers, « Lecture de Poussin », L’Intermédiaire, Seuil, 1963.
4 J. Thuillier, Simon Vouet, catalogue, Réunion des musées nationaux, 1990.
5 Ph. Sollers, « Lecture de Poussin », L’Intermédiaire, op. cit. J. Thuillier confirme le propos de Sollers dans sa biographie de Poussin, où il écrit : « La construction complexe de sa phrase dès qu’elle se veut grave ou solennelle, comme les images savantes et soigneusement développées, appartiennent à la rhétorique qu’on enseignait justement dans les premières années du siècle, et Poussin ne s’en débarrassa jamais. »
6 A. Mérot, Poussin, Hazan, 1990.
7 A. Félibien, Entretiens sur les vies et sur les ouvrages des plus excellents peintres anciens et modernes (1666-1688) : Nicolas Poussin, P. Cailler, 1947.
8 J. Thuillier, Nicolas Poussin, Fayard, 1988.
9 A. Félibien, Entretiens…, op. cit.
10 G. B. Passeri, Le Vite de’pittori, scultori ed architetti che hanno lavorato in Roma, morti dal 1641 fino al 1673 (1650-1679), Rome, 1772.
11 G. P. Bellori, Le Vite de’pittori, scultori ed architetti moderni (1672), Turin, 1976.
12 J. Thuillier, Poussin, op. cit.
13 Tallemant des Réaux, Historiettes, « Bibliothèque de la Pléiade », t. II, Gallimard.
14 M. Fumaroli, « L’Inspiration du poète » de Poussin, Réunion des musées nationaux, 1989.
15 Roger de Piles, cité par J. Thuillier dans Poussin, op. cit.
16 J. Thuillier, Poussin, op. cit.
17 Ibid.