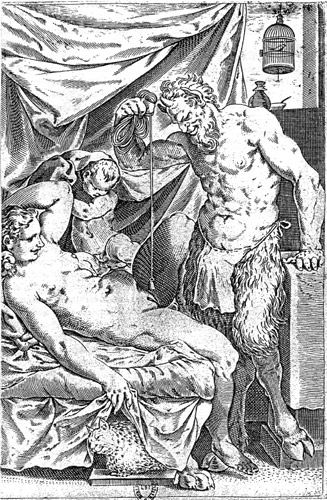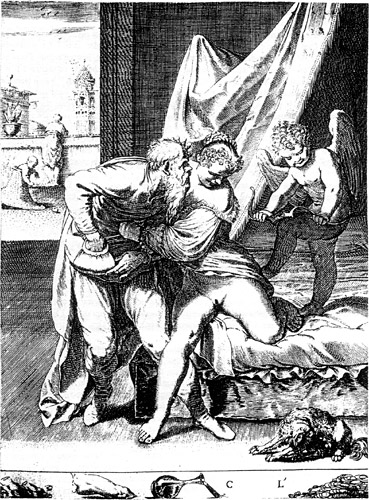IRONIE numéro 86 (mai 2003)
 |
 |

|
 |
 |
> IRONIE
numéro 86, mai
2003
Les Lascives D'Agostino
Carracci, Coda
|
 |
Supplément
du numéro
86,
Temps de merde (Extrait d'un roman en cours) |
|
Allez,
la musique
Septième
miroir : Sonder le rébus
Ces
deux dernières gravures offrent elles aussi un grand nombre de similitudes.
La composition générale, la fenêtre ouverte sur l'extérieur,
un lit surmonté de tentures. De l'une à l'autre, les principaux
protagonistes de la scène : à chaque fois, un homme, une femme,
un enfant. Enfin, la présence du chat dans le Satyre sondeur semble
répondre au chien du Vieillard et la courtisane.
 |
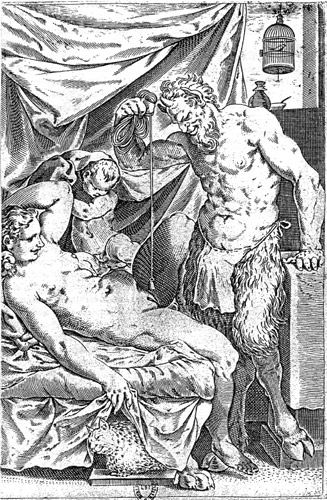 |
 |
|
Le Satyre
sondeur,
Agostino Carracci.
|
|
Le
sourire du satyre sondeur, le rire du chat, la malice active de la nymphe allongée,
le pendule à la recherche de la source... Le sexe se dresse sous le
pagne. L'enfant relève les tentures1, attend
le verdict, tous les regards rivés sur le mont-de-Vénus. La diagonale,
qui va du chat ronronnant sous les draps à l'oiseau dans sa cage (l'uccelo),
révèle la tension humoristique de cette gravure. A la Renaissance,
l'uccello sert souvent à représenter le sexe masculin.
Sexe ailé qu'on retrouve ensuite dans certaines gravures érotiques
du XVIIIème siècle. En revanche, le thème du
satyre sondeur est très rare, même s'il apparaît dans une
gravure de Jérôme Wiericx mettant en scène une vanité.
Agostino Carracci quant à lui ne retient que le divertissement érotique
des protagonistes dont les bras sont en miroir. A remarquer aussi les jeux
de pieds : du lit, de la femme, et du satyre.
Dans
l'autre gravure, le vieillard plonge sa main dans sa bourse2.
Drôle d'analogie entre l'or et le sperme, présente également
dans les représentations de Danaé (celles du Titien et du Tintoret,
par exemple), « allégorie », très courante
au XVIème siècle, de la courtisane. L'Amour brise
son arc, l'or vient à bout de tout, plus d'amour. Les puritains veulent
y lire une leçon de morale, stigmatisant les vieillards libidineux et
les courtisanes. Ainsi, dans une copie de cette gravure par Théodore
de Bry (1561-1629), une inscription latine a remplacé le
rébus d'origine : « Il est honteux de voir un soldat âgé et
davantage encore un vieillard amoureux ». Dans une autre copie
du XVIIIème siècle, c'est l'honnêteté de
la femme qui est épinglée, rebaptisée « la
femme de Putiphar ». Elle devient une femme séductrice, de « mauvaise
vie », l'Eve tentatrice de toujours. Cette femme peut aussi figurer
Vénus malmenée par les désirs de Vulcain ou une Suzanne
vénitienne, repoussant les avances empressées d'un vieillard
voyeur. Quoiqu'il en soit, l'attitude de la femme a l'air de contredire le
rébus. Il semble que l'or ne vienne pas forcément à bout
de tout. Le vieillard approche son visage, cherche un baiser. La femme refuse,
enfonce ses ongles dans son crâne chenu. Avons-nous affaire à une
courtisane ? S'agit-il d'un message désabusé sur l'amour ? Ou
est-ce plutôt une façon de railler une société déjà fixée
sur le pouvoir persuasif de l'argent ? Mais attention, si l'or vient à bout
de tout, il n'y a plus d'amour. L'arc se casse en deux et l'amour disparaît
sous un monceau d'or. L'Eros archer (archet) pour ce cas-ci remet son art à plus
tard. Le sondage est raté, brutal, le contraire du Satyre sondeur.
 |
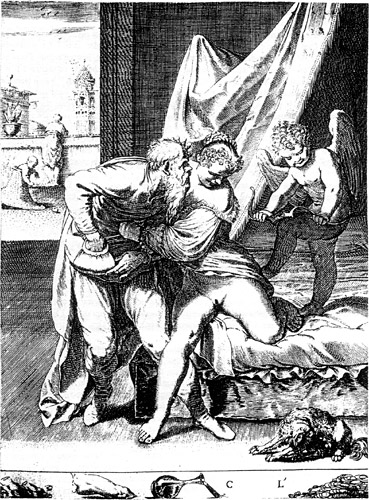 |
 |
|
Le Vieillard
et la courtisane,
Agostino Carracci.
|
|
 |
Bien
sûr rien n'est encore joué. Le spectateur se trouve dans la même
position qu'en face d'Orphée et Eurydice. Cette fois-ci, c'est
la femme qui doit choisir, ne pas regarder en arrière sous peine de
succomber aux baisers séniles, à l'Enfer. Que fait-elle ?
L'amène-t-elle vers le lit ? Ou écarte-t-elle les pattes
du vieux satyre ? Le spectateur est placé devant cette ambiguïté et
Agostino Carracci ne l'aide à aucun moment à conclure. L'artiste
ouvre à la lumière de Venise. Au second plan, vraiment au secret,
une autre scène de genre, sur la terrasse, scène ouverte, échappée
belle, fugue. Une femme ou un homme accoudé à un balcon, un enfant
en train de jouer, tâchant d'attraper une pomme. Déjà,
chez le petit Adam, la volonté de goûter au fruit de la connaissance,
d'en savoir plus sur le plaisir. Coincé dans une armature en osier,
l'enfant avance ses bras pour atteindre sa cible, rappel évident au
premier plan du vieillard, temps suspendu encore. De l'enfant au vieillard,
désir de jouir, le temps passe en un éclair. Et la silhouette,
tranquille, tournée vers Venise, le campanile de San Marco, vol d'oiseaux.
Le temps s'est envolé au loin, une seconde, mais reste là aussi,
fixé sur plusieurs points de la gravure. Peut-être est-ce Agostino
Carracci, ce personnage happé par Venise qui se détourne en douceur
des violences d'un monde voué à l'or. Il attend que sa femme,
Isabella, termine sa passe et laisse son fils, Antonio, à sa curiosité d'enfant.
Tout passe.
Le
jeu du montré et du caché dans ces deux dernières estampes
est particulièrement riche. D'un côté, un satyre sondant
le désir d'une femme, ce qui se cache derrière la pseudo énigme
de l'origine du monde. Et en face, un rébus à décrypter,
peut-être l'amorce d'une réponse. Agostino Carracci n'est pas
dupe et le grave de façon légère. Face au « Omnia
Vincit Amor »3 de Virgile, il appose « Ogni
cosa vince l'oro », sorte de morale à la manière de
La Fontaine. L'italien, le réel, la vie devant le latin, l'antiquité,
les mythes.
Il
faut maintenant s'arrêter sur le mot « sonder » et
sur le « rébus »... Echos des deux gravures...
D'abord la sonde sur le sexe de Vénus. Que cherche-t-il à savoir
ce satyre au sourire ? Sonder quoi ? La profondeur des eaux féminines ? « Reconnaître
par le moyen d'un plomb attaché au bout d'une corde, la profondeur d'une
eau dont on ne peut voir le fond ». Bien, mais encore ? « Sonder
le gué dans une affaire, tâcher de connaître s'il n'y a
point de danger, et de quelle façon il faudra s'y prendre ».
Comment s'y prendre avec les femmes ? Vaste question qui n'a pas fini
de préoccuper les hommes. D'abord, il est nécessaire de « sonder
le terrain, d'examiner soigneusement une affaire avant de l'entreprendre »,
puis « introduire un instrument fait exprès dans certaines
choses, pour en connaître la nature, la qualité ».
En chirurgie, on dit « reconnaître l'état d'une plaie,
en y introduisant une sonde ». Sonder, mot qui se généralise
au XVIème siècle, c'est aussi « essayer
de découvrir quelles sont les dispositions de quelqu'un. Je l'ai sondé(e)
là-dessus. Dieu qui sonde les cœurs (Bossuet) ».
Au final, « reconnaître qu'elles sont les dispositions où l'on
est ». Reconnaître les dispositions de soi et de l'autre,
sonder si l'instant est propice à l'amour, savoir si le moment est opportun, à saisir...
Entente, harmonie, musique de la sonde, soleil de plomb...
Le
rébus ensuite. « Rébus : jeu d'esprit qui consiste à exprimer,
au moyen d'objets figurés ou d'arrangements, les sons d'un mot ou d'une
phrase entière, qui reste à deviner ». Rébus,
de la formule latine de rebus quae geruntur, « au sujet des
choses qui se passent », libelle qui comportait des dessins énigmatiques.
Rébus Vénus, les choses de l'amour... Que voyons-nous ? Quel
est le message du graveur ? Que nous reste-t-il à deviner de cet admirable
jeu d'esprit que constitue chacune des gravures de cette suite ? En premier,
les sabots des satyres, les ongles des femmes : Unghie. En italien,
on pense aux expressions : cadere sotto le unghie di qualcuno (« tomber
sous les griffes de quelqu'un ») et ci manca un'unghia (« il
s'en faut d'un cheveu »). Unghie c'est-à -dire par
homophonie : Ogni : Tout, Pan, Omnia. La totalité,
hommes et femmes, tous et toutes, toutes ces estampes... En second, une cuisse
en lumière, una coscia, d'où est sorti, on s'en souvient,
Dionysos. Dans Coscia il faut entendre Cosa (chose). Per
prima cosa, avant toute chose, les cuisses, les choses, rébus in
rébus, les choses en rébus... Condensation, une phrase de choses,
une phase du tout. En troisième position, un flacon de vin à demi
versé (vino), sablier de l'ivresse. Puis la lettre C, d'où :
Vin'C, Vince (triomphe). Qu'importe le flacon, pourvu qu'on ait
l'ivresse. Ce vin nous gagne, victoire du vin, Dionysos encore... jusqu'au
dernier élément du rébus, l'or, L'Oro. L'or
triomphe de tout.
Tout
se mue en or, véritable alchimie-harmonie, du plomb qui sonde à l'or
final, le tout gravé sur cuivre, le métal de Vénus4.
Toute chose est vaincue par l'or. Ecoutons l'oro qui peut déguiser d'autres
sons, d'autres sens. L'or brille, le mot saute aux yeux, mais derrière
ce rébus trop clair, on peut lire d'autres sentences... L'oro s'entend
aussi loro (elles, eux). Toute chose est vaincue par elles ou les femmes
viennent à bout de tout, les femmes ou les hommes d'ailleurs. Ambiguïté des
gravures. Dans cette suite, les femmes mènent la danse, choisissent
le moment, leur plaisir ; elles viennent délicatement à bout
de tout. L'oro, c'est aussi lauro (le laurier), la couronne d'Orphée
comme celle d'Apollon, la musique, l'art du graveur. Retour à Orphée,
coda, à revoir depuis le début : Naissance de la Comédie.
Toute chose est vaincue par l'art, la musique, ou bien la musique, l'art – en
l'occurrence Les Lascives – viennent à bout de tout,
même de l'or... Agostino Carracci garde à jamais ce sourire satyre
et ce doigt sur sa bouche, un doux chut, un silence libertin.
Lionel
Dax
NOTES
1
On retrouve cette image de l'enfant relevant les tentures et l'ouverture
sur l'extérieur dans une des gravures de Bonasone : Un homme forçant
une femme sur un lit.
2 Cette « main au panier » renvoie aux masturbations du
satyre de la lascive n°9 et du vieillard de la lascive n°13.
3 Agostino Carracci s'est inspiré à plusieurs reprises (dessins,
gravures, fresques, peinture à l'huile) de ce vers de Virgile. « Omnia
Vincit Amor » : « L'amour triomphe de tout. Que l'amour
nous emporte » (Virgile). Omnia (« Tout » en
latin), représenté sous les traits du dieu Pan (« Tout » en
grec), était vaincu par Eros, Amor, Amour.
4 Le mot cuivre vient de Cyprium, c'est-à-dire l'île de
Chypre, connue pour ses importantes mines de cuivre. Chypre est aussi appelée
l'île de Vénus (Cypris).